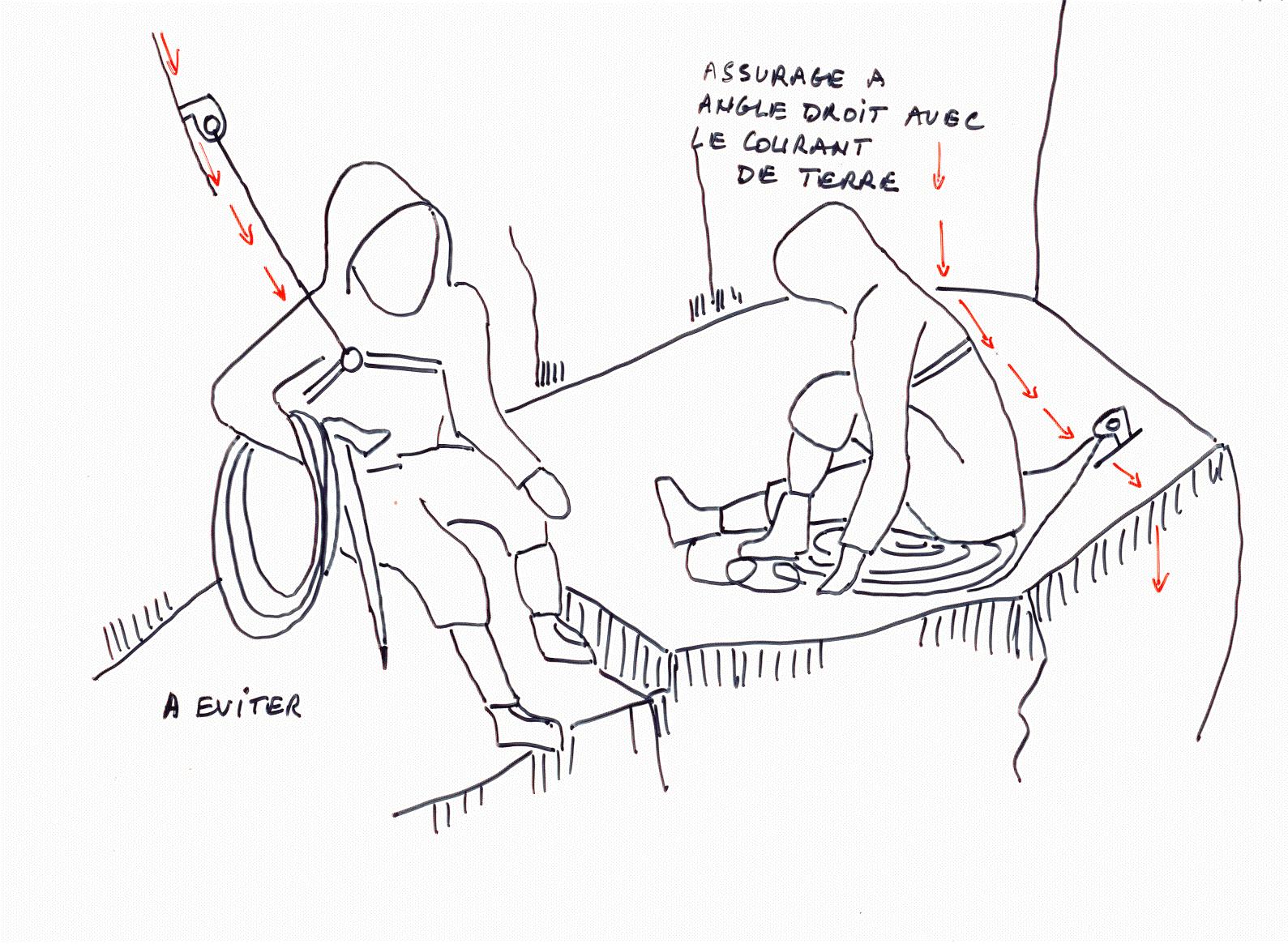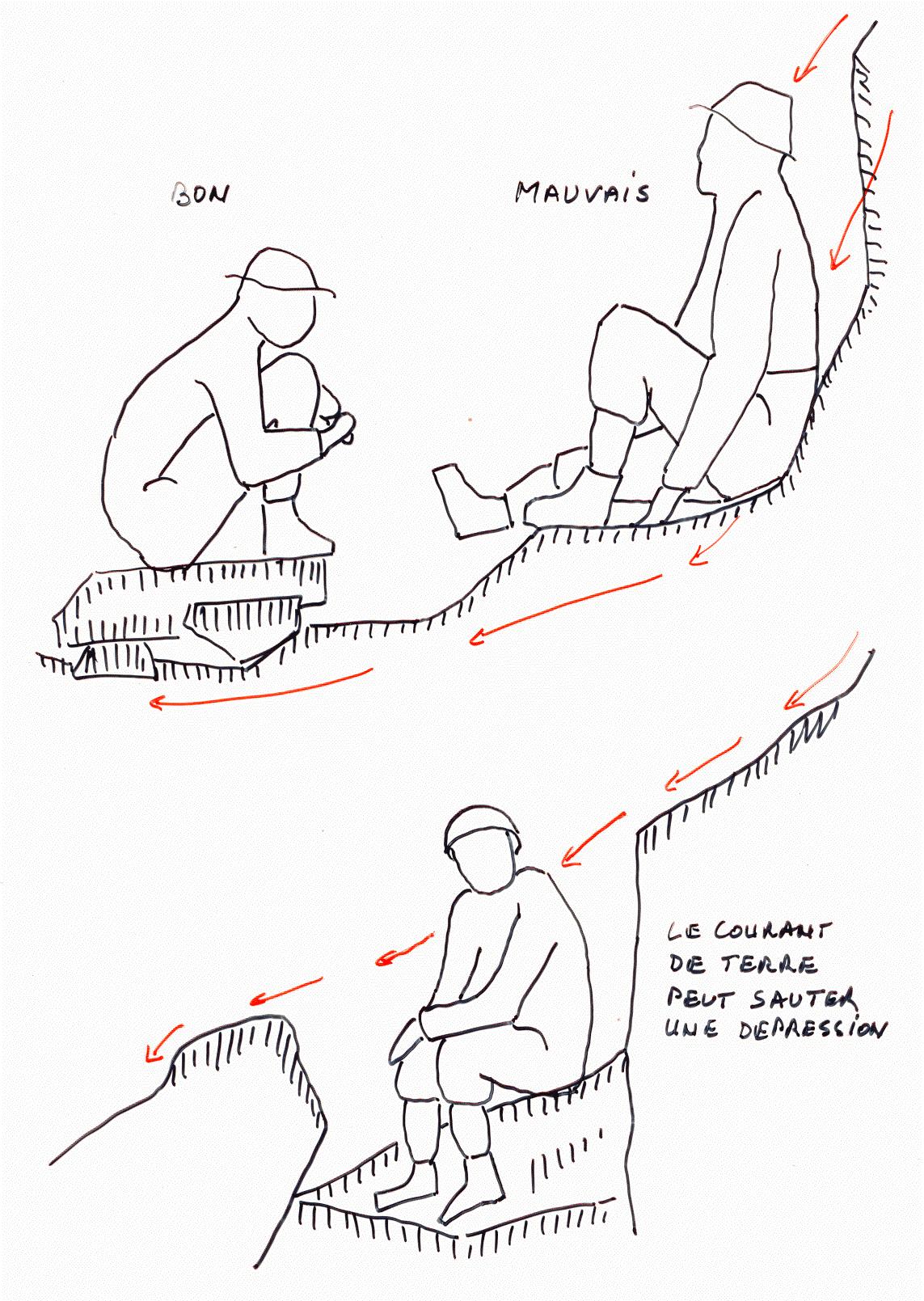Agressions liées à l’altitude / Altitude-related aggressions
Agressions de l’organisme liées à l’altitude
Ci-dessous nous allons traiter des agressions subies par l’organisme et
des moyens à mettre en œuvre pour réaliser un nouvel équilibre compatible avec la vie en altitude.
♦ Augmentation du froid pouvant provoquer des lésions
♦ Baisse de la pression atmosphérique pouvant provoquer le « mal des montagnes »
♦ Baisse de l’humidité atmosphérique
♦ Augmentation du rayonnement
— Le froid —
La sensation de froid est due à la vitesse de refroidissement de la surface de la peau.
Trois facteurs influent sur la vitesse de refroidissement : la température, la force du vent, et l’humidité de l’air.
La température baisse en moyenne de 0.8 degré par 100 mètres de dénivelé positif.
Le vent s’intensifie avec l’altitude.
En revanche, l’humidité de l’air diminue.
Vers 2000 mètres l’humidité relative a diminué de moitié par rapport au niveau de la mer, et des trois-quarts à 4000 mètres. Ce facteur de refroidissement diminue donc au fur et à mesure que l’on monte. Il faut savoir que la conduction thermique de l’eau est 20 fois supérieure à celle de l’air, ce qui explique qu’un froid humide est plus difficile à supporter qu’un froid sec.
L’homme ne peut vivre que dans une fourchette de température très étroite autour de 37 degrés. Il doit donc constamment gérer son capital thermique. Quand sous l’effet du froid les pertes de chaleur dépassent les gains, l’organisme va réagir de deux façons, il va : limiter les pertes en diminuant le débit sanguin cutané, et augmenter la production interne de chaleur.
Diminution du débit sanguin cutané
La peau contrôle en permanence les échanges thermiques de notre corps avec l’extérieur. Pour préserver les organes vitaux d’une baisse dangereuse de température, la peau va diminuer son irrigation sanguine.
Le bénéfice est double:
(1) une peau froide constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur, car moins irriguée elle est moins conductrice de chaleur;
(2) le sang ne circulant plus en surface et dans les extrémités, il se refroidit moins.
Production interne de chaleur
La thermogenèse peut être volontaire. L’exercice physique est un bon moyen de se réchauffer mais il consomme de l’énergie. Les aliments apportent en plus de leur valeur nutritionnelle un gain de chaleur à la digestion.
Elle peut être aussi involontaire. Le frisson est une contraction musculaire involontaire visant à produire de la chaleur. La sécrétion hormonale intervient dans la lutte contre le froid en augmentant les métabolismes.
Les lésions dues au froid
♦ Gelures ♦ Hypothermie
Les gelures
La gelure est une brûlure par le froid. Les gelures affectent « l’écorce » du corps, c’est à dire la peau et les extrémités. Elles ne menacent pas directement la vie. En fait, c’est comme si « l’écorce » se sacrifiait pour préserver les organes vitaux.
Ce qui fait le danger des gelures c’est qu’elles s’installent sans prévenir, de façon progressive et insidieuse. Lorsqu’il y a risque de gelure, chaque membre de la cordée doit observer ses compagnons afin de déceler une éventuelle apparition de plaques blanchâtres sur le nez, les joues ou les oreilles. Ces gelures, si elles sont fréquentes ne sont jamais très graves.
Plus graves sont les gelures des doigts et des orteils. Il faut se souvenir que lorsqu’il y a du vent des gelures peuvent survenir assez rapidement. L’humidité est un facteur aggravant.
Vitesse du vent (Km/h) |
Température ressentie (°C) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| 5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 |
| 10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 |
| 15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 |
| 20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 |
| 30 | 0 | -7 | -14 | -20 | -26 | -33 |
| 50 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 |
| 70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 |
-10 à -24: La peau nue exposée ressent le froid. Risque d’hypothermie si l’exposition est de longue durée et sans protection. Porter plusieurs couches de vêtements, un chapeau et des gants.
-25 à -37: Risque de gel de la peau (gelure grave). Surveiller tout engourdissement ou blanchiment de la figure, des doigts, des oreilles et du nez. Risque d’hypothermie si l’exposition est d’assez longue durée et sans protection. Porter plusieurs couches de vêtements, un bonnet et des gants chauds. Couvrir le visage.
Ne jamais frictionner des membres gelés car les tissus sont fragiles, bien qu’ils soient insensibles. Ne jamais réchauffer à la chaleur d’une flamme car la température est trop élevée.
Une règle importante: Il ne faut entreprendre le réchauffement d’un membre gelé que si l’on est sûr de pouvoir entretenir un réchauffage constant et suffisant jusqu’à l’évacuation. Un réchauffage lent et insuffisant, souvent suivi de re-gelure fait encourir de sérieuses complications.
Il faut savoir qu’une extrémité réchauffée est inutilisable et le montagnard devient un impotent.
Au vu des expériences vécues et des constatations médicales, on peut marcher longtemps avec des pieds gelés sans risquer davantage de complications.
Ne pas hésiter à organiser l’évacuation !
L’hypothermie
L’hypothermie commence lorsque la production de chaleur par l’organisme ne couvre plus les pertes caloriques. Des lésions par hypothermie peuvent donc survenir par des températures supérieures à zéro degré. Il faut se souvenir que la perte de chaleur corporelle n’est pas seulement fonction de la température, mais surtout du vent et dans une moindre mesure de l’humidité.
Il est vital de rester calme et bien maîtriser la situation afin d’éviter un gaspillage de calories. Les décharges d’adrénaline dues au stress et à la panique brûlent très rapidement les réserves de l’organisme. Il est arrivé que des randonneurs peu expérimentés perdus en moyenne montagne meurent en une nuit. Boire, manger et rester calme aideront à sortir de cette mauvaise situation.
La perte de chaleur moyenne, au repos et sans vent, est estimée à 2.8 degrés/heure dans la neige et 4.1 degrés heure en plein air. Après une heure trois quart passé dans la neige, sous une avalanche par exemple, le corps est à 32 degrés, température à laquelle commencent les perturbations physiques.
Après quatre heures un quart, le corps est à 25 degrés et il y a risque de mort.
Le diagnostic est en général évident. Jusqu’à 35 degrés, l’individu reste conscient et peut décrire ses sensations.
Au dessous de 33 degrés, les idées ne sont plus très claires. La peau est froide, le visage livide, le pouls est faible et rapide. Par moment le malade est agité de tremblements.
Il faut tout de suite soustraire le malade du froid. Lui mettre des habits secs, se mettre avec lui dans un duvet préchauffé, lui donner des boissons chaudes et sucrées, placer des gourdes d’eau chaude sous les aisselles et entre les cuisses.
Surtout éviter un brassage rapide du volume sanguin entre la périphérie froide et le centre resté plus chaud. Pas de frictions, pas de mouvements et… pas d’alcool.
L’hypothermie est une urgence médicale !
— Baisse de la pression atmosphérique —
Lorsque l’altitude augmente la pression atmosphérique diminue et, parallèlement, celle de l’oxygène aussi.
A 2500 mètres, la pression de l’oxygène n’est plus que les trois quarts de ce qu’elle est au niveau de la mer, à 5500 mètres la moitié et à 8500 mètres le tiers. Or, la pression est la seule force qui fait progresser l’oxygène de l’air ambiant aux cellules de l’organisme.
Pour éviter l’hypoxie (oxygénation insuffisante) et les risques de mal des montagnes, une adaptation des mécanismes physiologiques va s’effectuer au niveau respiratoire avec une augmentation du volume de l’air inspiré, au niveau sanguin avec une augmentation du nombre de globules rouges et enfin au niveau cellulaire, en permettant une meilleure libération de l’oxygène de son transporteur.
Le mal des montagnes regroupe un ensemble de symptômes qui se manifestent à des degrés divers selon les personnes.
Il se manifeste généralement par des maux de tête, des nausées, un manque d’appétit, des étourdissements et des insomnies. Dans la majorité des cas, tout rentre dans l’ordre au bout de quelques jours.
L’apparition de vomissements, la diminution du débit urinaire et la persistance de violents maux de tête malgré l’aspirine, sont les manifestations d’un oedème cérébral.
Des difficultés respiratoires, la toux, un sentiment d’oppression dans la cage thoracique, la faiblesse et, finalement, la fièvre sont les manifestations d’un oedème pulmonaire.
Le mal aigu des montagnes (le MAM) peut affecter les personnes à partir d’une altitude de 2000 mètres déjà. Les symptômes apparaissent de 4 à 8 heures après l’arrivée en altitude. Ils évoluent en 3 à 4 jours.
Les enfants sont particulièrement vulnérables.
Pour prévenir le MAM il faut boire abondamment et avoir une alimentation de type hyper glucidique.
Une progression lente est le meilleur moyen de minimiser les risques.
En cas de doute, il faut impérativement descendre,
à une altitude inférieure d’au moins 500 mètres.
— Baisse de l’humidité atmosphérique —
La quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air diminue avec l’altitude.
A 4000 mètres, la tension de vapeur d’eau ne représente plus que le quart de sa valeur au niveau de la mer.
Si on ajoute à cela que le volume d’eau contenu dans l’air est plus faible aux températures basses qu’aux températures élevées, il devient manifeste que l’air qui entoure le montagnard est sec.
Cet air sec augmente la déshydratation contre laquelle l’organisme n’a aucune protection. Cet air sec et froid est aussi à l’origine de l’irritation des voies respiratoires et des maux de gorge.
La déshydratation a une conséquence directe sur la performance physique.
Une perte d’eau de 2 % du poids du corps (soit un litre et demi pour 80 kilos)
diminue la performance de 20 %
— Augmentation du rayonnement —
Les rayons dont il faut se protéger sont les Ultra-Violets (UV). Il y a trois sortes d’UV: les UVC, UVB et UVA par ordre décroissant de nocivité. Les UVC sont arrêtés par l’atmosphère et ne nous atteignent pratiquement pas. Par contre toute exposition prolongée aux UVB et UVA va provoquer des brûlures de la peau et des yeux.
Plus on s’élève, plus la couche de protection atmosphérique diminue et le rayonnement UVB augmente.
L’intensité du rayonnement augmente de 4% tous les 300 mètres.
En outre, plus le soleil est bas sur l’horizon, plus la traversée atmosphérique est longue et moins intense est le rayonnement qui parvient jusqu’au sol. Il y a donc un maximum d’UVB entre 11 h et 14 h. Les rayons ne tombent pas tout droit sur la terre. Ils sont diffusés par l’air, les particules de vapeur d’eau et de poussière.
Si les alto-cumulus de moyenne altitude absorbent la majeure partie des UV,
Les cirrus de haute altitude qui donnent un ciel gris très lumineux transmettent presque autant d’UV qu’un ciel clair. La réflexion du sol dépend de sa nature, elle peut être importante (jusqu’à 90% sur la neige).
Altitude-related stresses on the body
Below we look at the stresses on the body and how to achieve a new balance compatible with life at altitude.
♦ Increased cold can cause injury
♦ Decrease in atmospheric pressure may cause « mountain sickness
♦ Decrease in atmospheric humidity
♦ Increased radiation
— Cold weather —
The sensation of cold is due to the rate at which the surface of the skin cools.
Three factors influence the rate of cooling: temperature, wind strength and air humidity.
The temperature drops by an average of 0.8 degrees per 100 metres of positive ascent.
The wind increases with altitude.
On the other hand, air humidity is falling.
At around 2,000 metres, relative humidity is half that at sea level, and three-quarters at 4,000 metres. This cooling factor therefore decreases as you climb. It should be remembered that water is 20 times more thermally conductive than air, which explains why it is more difficult to bear a damp cold than a dry one.
Humans can only live within a very narrow temperature range of around 37 degrees. We must therefore constantly manage our thermal capital. When the cold causes heat loss to exceed heat gain, the body reacts in two ways: it limits heat loss by reducing cutaneous blood flow, and it increases internal heat production.
Decreased cutaneous blood flow
The skin constantly controls our body’s heat exchange with the outside world. To protect vital organs from a dangerous drop in temperature, the skin reduces its blood supply.
the benefits are twofold:
(1) cold skin acts as an effective barrier against heat loss, as it has less blood supply and conducts less heat;
(2) as blood no longer circulates on the surface and in the extremities, it cools less.
Internal heat production
Thermogenesis can be voluntary. Physical exercise is a good way of warming up, but it consumes energy. In addition to their nutritional value, foods also provide heat gain during digestion.
It can also be involuntary. Shivering is an involuntary muscle contraction designed to produce heat. Hormone secretion plays a part in combating the cold by increasing metabolisms.
Cold injuries
♦ Frostbite ♦ Hypothermia
Frostbite
Frostbite is a cold burn. Frostbite affects the « crust » of the body, i.e. the skin and extremities. It is not a direct threat to life. In fact, it is as if the « bark » were sacrificing itself to preserve the vital organs.
The danger of frostbite is that it sets in without warning, gradually and insidiously. When there is a risk of frostbite, each member of the rope party must observe his companions to detect any appearance of whitish patches on the nose, cheeks or ears. Frostbite, though frequent, is never very serious.
More serious are frostbite of the fingers and toes. Remember that frostbite can occur quite quickly in windy conditions. Humidity is an aggravating factor.
Wind speed (Km/h) |
Temperature felt (°C) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| 5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 |
| 10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 |
| 15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 |
| 20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 |
| 30 | 0 | -7 | -14 | -20 | -26 | -33 |
| 50 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 |
| 70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 |
-10 to -24: Exposed bare skin feels the cold. Risk of hypothermia if exposed for long periods without protection. Wear several layers of clothing, a hat and gloves.
-25 to -37: Risk of skin freezing (severe frostbite). Watch for numbness or whitening of the face, fingers, ears and nose. Risk of hypothermia if exposure is long enough and unprotected. Wear several layers of clothing, a hat and warm gloves. Cover your face.
Never rub frozen limbs as the tissues are fragile, even though they are insensitive. Never heat with an open flame, as the temperature is too high.
An important rule: a frozen limb should only be rewarmed if you are sure you can maintain constant and sufficient rewarming until evacuation. Slow and insufficient rewarming, often followed by refreezing, can lead to serious complications.
It should be remembered that a reheated extremity is unusable and the mountaineer becomes impotent.
In the light of experience and medical findings, you can walk for a long time with frozen feet without risking further complications.
Don’t hesitate to organise an evacuation
Hypothermia
Hypothermia begins when the body’s production of heat no longer covers the loss of calories. Hypothermic injuries can therefore occur at temperatures above zero. It is important to remember that body heat loss is not only a function of temperature, but also of wind and, to a lesser extent, humidity.
It’s vital to remain calm and in control of the situation to avoid wasting calories. The adrenalin rushes caused by stress and panic burn up the body’s reserves very quickly. Inexperienced hikers lost in mid-mountain terrain have been known to die overnight. Drinking, eating and staying calm will help you get out of this bad situation.
The average heat loss, at rest and with no wind, is estimated at 2.8 degrees/hour in the snow and 4.1 degrees/hour in the open air.
After an hour and three quarters spent in the snow, under an avalanche for example, the body is at 32 degrees, the temperature at which the physical disturbances begin. After four and a quarter hours, the body is at 25 degrees and there is a risk of death.
The diagnosis is usually obvious. Up to 35 degrees, the individual remains conscious and can describe his sensations.
Below 33 degrees, ideas are no longer very clear. The skin is cold, the face livid, the pulse weak and rapid. At times the patient is agitated by tremors.
The patient must be taken out of the cold immediately. Dress him in dry clothes, lie down with him in a pre-warmed duvet, give him hot, sweet drinks and place bottles of hot water under his armpits and between his thighs. Above all, avoid rapid mixing of blood volume between the cold periphery and the warmer centre. No friction, no movement and… no alcohol.
Hypothermia is a medical emergency!
—Drop in atmospheric pressure—
As altitude increases, atmospheric pressure decreases and, at the same time, so does oxygen pressure.
At 2500 metres, oxygen pressure is only three quarters of what it is at sea level, at 5500 metres half and at 8500 metres one third. Yet pressure is the only force that moves oxygen from the ambient air to the body’s cells.
To avoid hypoxia (insufficient oxygenation) and the risk of mountain sickness, physiological mechanisms will adapt at respiratory level by increasing the volume of air inspired, at blood level by increasing the number of red blood cells and finally at cellular level, by allowing better release of oxygen from its carrier.
Mountain sickness brings together a range of symptoms that manifest themselves to varying degrees depending on the individual.
It generally manifests itself as headaches, nausea, lack of appetite, dizziness and insomnia. In most cases, everything returns to normal after a few days.
The appearance of vomiting, reduced urine output and the persistence of violent headaches despite aspirin are signs of cerebral oedema.
Difficulty breathing, coughing, a feeling of tightness in the chest, weakness and, finally, fever are the signs of pulmonary oedema.
Acute mountain sickness (AMS) can affect people at altitudes of 2000 metres and above. Symptoms appear 4 to 8 hours after arriving at altitude. They progress over 3 to 4 days. Children are particularly vulnerable.
To prevent ASM, you need to drink plenty of fluids and eat a high-carbohydrate diet.
Slow progression is the best way to minimise the risks.
If in doubt, you must descend, at least 500 metres lower.
—Lower atmospheric humidity—
The amount of water vapour in the air decreases with altitude.
At 4000 metres, water vapour pressure is only a quarter of its value at sea level.
If we add to this the fact that the volume of water contained in the air is lower at low temperatures than at high temperatures, it becomes clear that the air surrounding the mountain dweller is dry.
This dry air increases dehydration, against which the body has no protection. This dry, cold air also causes irritation of the respiratory tract and sore throats.
Dehydration has a direct impact on physical performance.
A water loss of 2% of body weight (i.e. one and a half litres for 80 kilos)
reduces performance by 20%
—Increased radiation—
The rays we need to protect ourselves from are ultraviolet rays (UV). There are three types of UV: UVC, UVB and UVA, in decreasing order of harmfulness. UVC is blocked by the atmosphere and hardly reaches us at all.
However, prolonged exposure to UVB and UVA will cause burns to the skin and eyes.
The higher you go, the more the layer of atmospheric protection diminishes and UVB radiation increases.
The intensity of the radiation increases by 4% every 300 metres.
What’s more, the lower the sun is on the horizon, the longer it takes to cross the atmosphere and the less intense the radiation that reaches the ground. There is therefore a maximum of UVB between 11am and 2pm. The rays do not fall straight to earth. They are scattered by the air, water vapour and dust particles.
While mid-altitude alto-cumulus clouds absorb most of the UV,
High-altitude cirrus clouds, which give a very bright grey sky, transmit almost as much UV as a clear sky.
Reflection from the ground depends on its nature, and can be significant (up to 90% on snow).